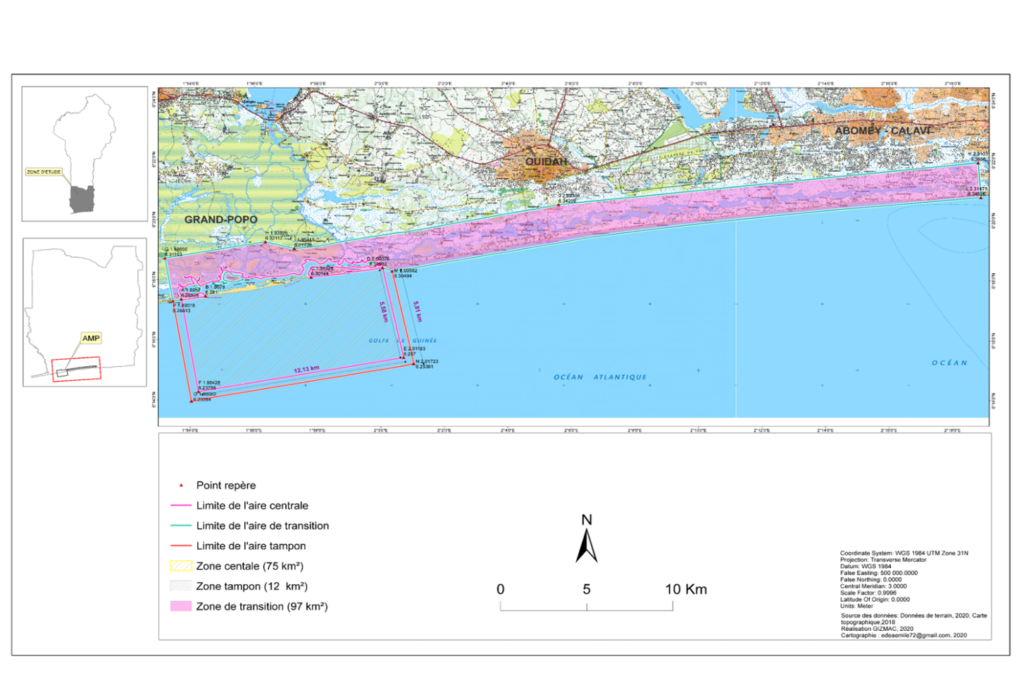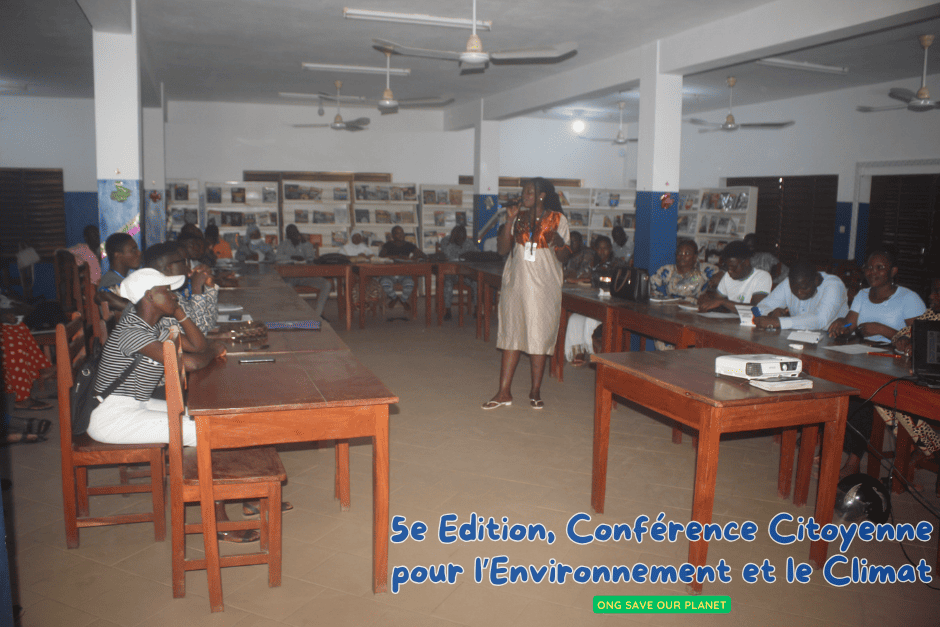COP16 Bis à Rome : une feuille de route adoptée pour le financement de la biodiversité
Les États ont trouvé un accord sur une feuille de route pour mobiliser les financements nécessaires à la protection de la biodiversité, avec un accent particulier sur les transferts de fonds entre pays du Nord et du Sud. La Conférence des Parties sur la biodiversité (COP16) avait débuté en octobre 2024 à Cali, en Colombie. Toutefois, les discussions avaient été suspendues faute d’accord sur une question clé : le financement. C’est donc à Rome, du 25 au 27 février 2025, que les négociations ont repris. Après d’intenses débats, un accord a finalement été trouvé, traçant la voie vers une meilleure mobilisation des ressources pour préserver la biodiversité mondiale.

Le continent africain, riche en biodiversité mais vulnérable face aux défis environnementaux, est au cœur des discussions sur le financement. Lors de la COP15 en 2022, les États avaient convenu de mobiliser 200 milliards de dollars pour la protection de la biodiversité d’ici 2030. Parmi ces fonds, 30 milliards de dollars doivent être transférés chaque année des pays riches vers les pays en développement.
Cependant, un désaccord persistait : comment organiser ces transferts ? Les pays en développement, dont plusieurs en Afrique, plaidaient pour la création d’un nouveau fonds dédié. À l’inverse, les pays développés préféraient utiliser les structures existantes, estimant qu’il y avait déjà trop de mécanismes de financement fragmentés. Finalement, la question a été reportée à 2028, lors de la COP18. D’ici là, l’argent pourra transiter par plusieurs canaux, mais l’Afrique devra veiller à ce que ses besoins spécifiques ne soient pas oubliés.
De belles promesses, mais encore peu d’actes concrets
L’accord de Rome a été accueilli avec un mélange d’espoir et de scepticisme. « Nous avons maintenant une feuille de route, mais il faut des engagements concrets, de l’argent sur la table », a commenté An Lambrechts, représentante de Greenpeace International.
Ce sentiment est partagé par de nombreux observateurs en Afrique. En effet, la biodiversité africaine est menacée par la déforestation, l’exploitation minière et le changement climatique, mais les financements internationaux tardent souvent à arriver sur le terrain. Plusieurs pays du Sud exigent donc que les promesses se traduisent en actions concrètes, notamment à travers un accès simplifié aux fonds et une transparence accrue.
Laura Caicedo, de Greenpeace Colombie, rappelle que l’accord de Rome est un signal positif, mais insiste : « Les pays du Nord doivent maintenant tenir parole et débloquer des fonds réels pour protéger la biodiversité en Afrique, en Amérique latine et dans le monde. »
Si certains saluent cet accord comme une victoire, d’autres le voient comme une manœuvre politique pour éviter une crise de confiance entre pays du Nord et du Sud. Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la Transition écologique, s’est félicitée que le texte n’ait pas créé un nouveau fonds. Pourtant, de nombreux pays africains estiment qu’une structure spécifique leur permettra de mieux accéder aux financements et d’éviter que l’argent soit dilué dans des mécanismes trop complexes.
Et maintenant ? Quels impacts pour l’Afrique ?
L’accord prévoit plusieurs étapes avant la COP18 en 2028. Il s’agit d’identifier les obstacles au financement de la biodiversité, afin de lever les freins administratifs et politiques. Mobiliser toutes les sources de financement disponibles, qu’elles soient publiques ou privées, nationales ou internationales. Faciliter le dialogue entre les ministres de l’environnement et des finances, un point clé pour éviter que la biodiversité ne soit reléguée au second plan dans les budgets des États.
Par ailleurs, deux autres décisions importantes ont été prises lors de cette COP16 bis : Des indicateurs de suivi pour l’accord de Kunming-Montréal ont été adoptés. Cet accord vise notamment à protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030.
Le lancement officiel du Fonds Cali. Ce fonds doit permettre de partager les bénéfices des entreprises qui utilisent des informations issues du séquençage du patrimoine génétique mondial. Cependant, il reste pour l’instant… vide.
L’Afrique doit rester vigilante
Le processus est donc en marche, mais l’Afrique doit s’assurer que ces décisions ne restent pas de simples déclarations. Avec ses forêts, ses savanes, ses mangroves et sa faune exceptionnelle, le continent est un maillon essentiel de la biodiversité mondiale. Pourtant, il ne reçoit qu’une part infime des financements disponibles.
La mobilisation de la société civile africaine sera donc cruciale pour suivre les engagements pris et exiger des résultats concrets. Sans financements adéquats, la protection des écosystèmes africains reste un vœu pieux.
Megan Valère SOSSOU