Mise en conformité de stratégie d’interventions en nutrition du projet Cascade : Les PMO actualisent leur plan d’actions et de plaidoyer
La ville de Covè abrite l’atelier de l’Alliance de la Société Civile pour l’intensification de la Nutrition au Bénin (ASCINB). Cette rencontre qui s’est ouverte ce lundi 28 juillet 2025, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet CASCADE sous financements de Care International Bénin-Togo, le Royaume des Pays-Bas et de Gain.
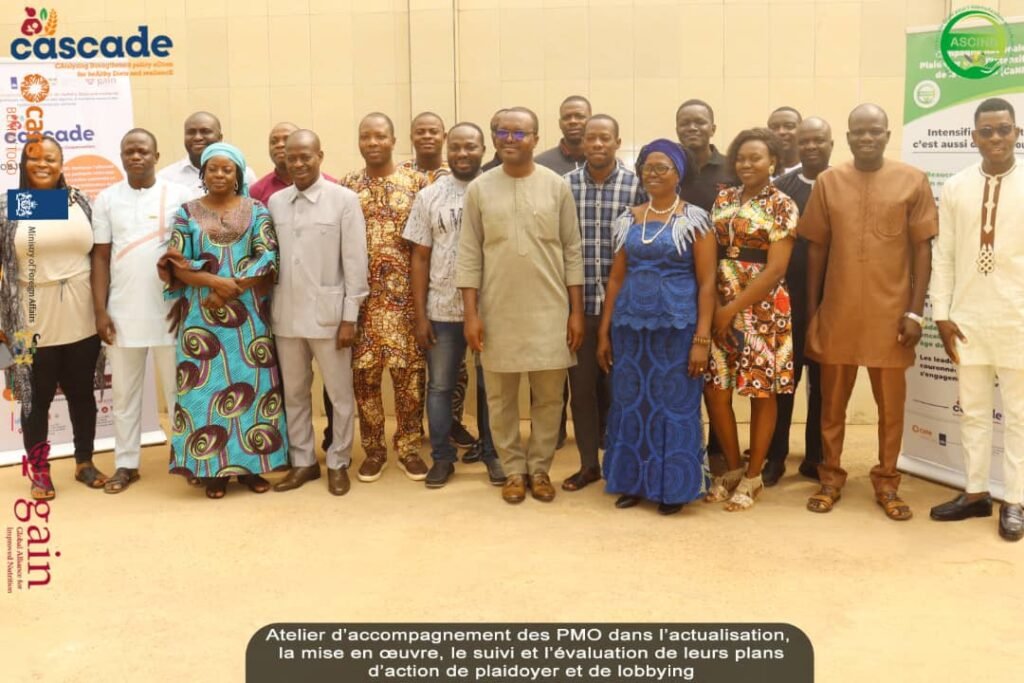
Renforcer les capacités des Pmo à porter un plaidoyer contextualisé relatif aux questions de l’alimentation, de nutrition en vue d’atteindre les résultats escomptés. Tel est le principal mobile qui sous-tend l’organisation de cette rencontre. «De façon spécifique, nous voulons travailler pour actualiser, s’il existe, les plans de plaidoyers ou engager des embauches de plan de plaidoyer et lobbying pour que chaque Pmo dispose d’une feuille de route claire de cette intervention dans le domaine de plaidoyer » a explicité Angélo Kanclounon, responsable plaidoyer de l’ASCINB.
Durant leur séjour de 48heures en région Agonlin, chaque PMO aura donc à identifier et à planifier ses différentes actions sur lesquelles il pourra bénéficier de l’accompagnement de l’ASCINB pour le suivi et l’évaluation du plaidoyer et de lobbying. Lors de cet atelier qui a réuni les acteurs, des ONG membres et partenaires de l’ASCINB, il sera question d’ébaucher le plan d’action, d’harmoniser les pratiques et les stratégies d’intervention sur le terrain en vue de mieux appuyer les communautés à aller de l’avant en ce qui concerne le plaidoyer et la nutrition communautaire.


Pour le Dr Lougoudou Zato, Secrétaire exécutif de l’ASCINB, il s’est agi d’une séance de partage d’expériences et de bilan d’exécution des plans de plaidoyers qui permettra d’évoquer les difficultés qui se posent et de revoir la stratégie de communication en ce qui concerne les rase pour qu’à la revue les indicateurs puissent être améliorés. En procédant à l’ouverture des travaux de l’atelier de mise en conformité de la stratégie d’interventions en nutrition du projet Cascade, la Vice-Présidente de l’ASCINB, a souligné l’importance de la rencontre d’où sortiront des intrants et des extrants possibles pour avancer. « Cet atelier est un tournant décisif pour la stratégie de plaidoyer du projet Cascade dirigé et mis en œuvre par les Pmo » a insisté Pascaline Fagninou Gbaguidi qui a exhorté les participants à une participation active.
Edmond Zinzindohoué, Chargé de projet CASCADE, a salué l’engagement des participants en soulignant qu’ils ont répondu à un appel pressant : celui d’agir pour le changement à travers le plaidoyer. Il a souhaité que les travaux des organisations puissent être mis en cohérence avec la stratégie élaborée avec l’expertise de l’ASCINB. Selon lui, en unissant leurs efforts, les acteurs pourront faire entendre leur voix et influencer positivement les décisions des autorités.
A retenir que le projet Cascade est une initiative du Gouvernement qui vise à renforcer l’efficacité des politiques nationales de nutrition existantes en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire et la contribution à la réduction de la malnutrition des femmes en âge de procréer et des enfants. il est mis en œuvre dans les départements du Zou, de l’Ouémé, du Couffo, de l’Atacora de l’Alibori et dans le Borgou.
Zéphirin Toasségnitché













