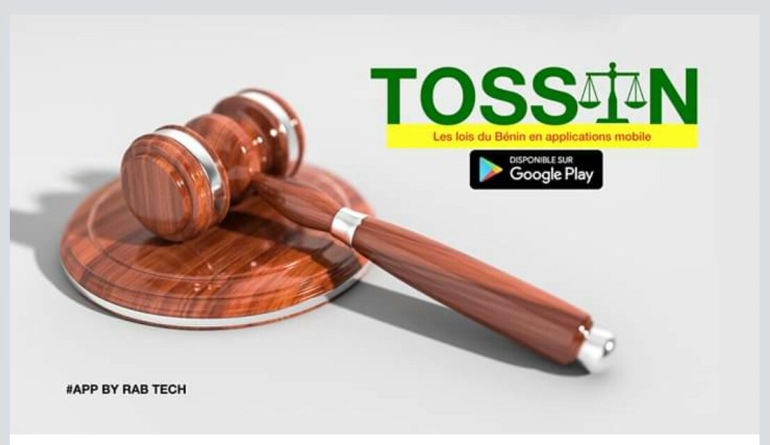Lancement du programme Voix EssentiELES au Bénin : une nouvelle ère pour l’inclusion et le leadership des femmes
Ce mercredi 12 mars 2025, la Salle Cèdre de l’hôtel Golden Tulip de Cotonou a accueilli le lancement de la deuxième phase du programme Voix EssentiELLES au Bénin, initié par Speak Up Africa avec le soutien financier du Fonds Mondial et de la Fondation CHANNEL. Placée sous le signe d’une solidarité renforcée entre partenaires, cette nouvelle phase vise à amplifier l’impact du programme au Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire.

Frantz Oke, Coordonnateur de Speak Up Africa Bénin, a ouvert la rencontre en souhaitant la bienvenue aux partenaires, aux bénéficiaires et aux représentants des médias. Il a ensuite présenté Speak Up Africa, une organisation engagée dans la transformation sociale et le renforcement du leadership des femmes et des filles en Afrique francophone.
L’introduction de Voix EssentiELLES au Bénin met un accent particulier sur la voix, la prise de décision et le leadership des femmes, des éléments clés de leur autonomisation. L’objectif est de garantir une participation significative des femmes et des filles dans toutes les sphères de prise de décision.
En assurant une inclusion effective des femmes et des filles dans toute leur diversité, Voix EssentiELLES s’attache à influencer positivement les politiques et programmes de santé en Afrique de l’Ouest et du Centre a rappelé Marielle Montcho.
Un programme pour l’autonomisation et la prise de décision des femmes
Les organisations et réseaux locaux impliqués dans cette deuxième phase ont ensuite présenté leurs thématiques de travail et leurs zones d’intervention. Speak Up Africa collabore avec 15 organisations au Burkina Faso, 12 en Côte d’Ivoire et 10 au Bénin, en partenariat avec des réseaux médiatiques comme le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN).
Au Bénin, une dizaine d’organisations bénéficient du programme, parmi lesquelles : ROAJELF, FADEC ONG, ICONE 360, Fondation des Jeunes Amazones pour le Développement, Réseau des Féministes du Bénin, Fondation Reine Hangbé, Bénin Women Alumni Association, Fondation de la Reine Natabou de Toviklin, et bien d’autres.

“Ces organisations vont travailler d’arrache pied pour mettre en place des plaidoyers efficaces qui visent à obtenir soit des lignes budgetaires, soit des changements de politique au niveau local et national pour l’amélioration de l’accès au service de santé pour les femmes dans leurs communautés” a laissé entendre Christiane Yelibi, Coordonnatrice Voix Essentielles.
Tout en saluant les projets portés par les bénéficiaires, Dr Odjè Adeichan, secrétaire permanent de l’instance Nationale de Coordination des Ressources du Fonds Mondial a invité à une gestion transparente des ressources à allouer.
Victorine Kemonou Djitrinou, Présidente de la Fondation Reine Hangbe se réjouit de l’appui de Speak Up Africa pour relever le défi des droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles dan la ville de Porto-Novo.
Comme elle, sa majesté Adjignon Natabou, Présidente de la Fondation Reine Adjignon Natabou est convaincue que l’accompagnement de l’initiative Voix Essentielles permettra de conduire une communication stratégique pour la lutte contre le paludisme dans la zone sanitaire Klouekanme-Toviklin – Lalo avec l’implication des leaders religieux et traditionnels.
La Présidente du Caucus des Femmes Parlementaires du Bénin, He Djamilatou Sabi Mohamed, et l’Honorable Aké Natondé ont exprimé leur enthousiasme quant à la participation du Bénin à ce programme, soulignant l’implication des parlementaires béninois dans la réussite de Voix Essentielles.
Rappelons que depuis 2021, Voix Essentielles a permis à plus d’une vingtaine d’organisations et de réseaux locaux de femmes et de filles Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d’Ivoire de jouer un rôle actif dans le changement des paradigmes sociaux.
Mahougnon Josué Tchagnonsi