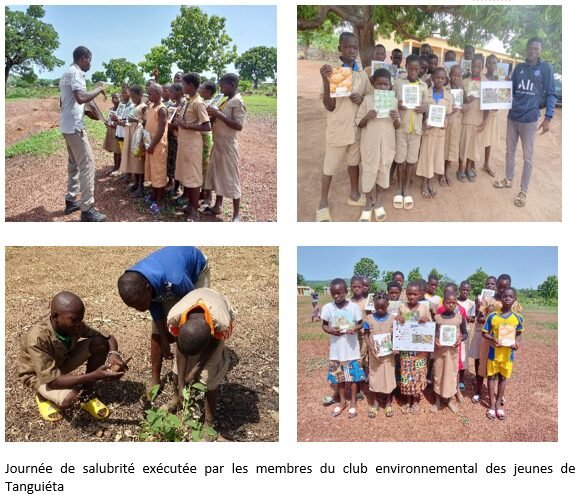PAS II : Renforcer la communication des statistiques officielles pour une Afrique plus éclairée
Le Programme Panafricain de Statistiques II (PAS II) a clôturé aujourd’hui ses rencontres stratégiques sur la communication des statistiques officielles à Casablanca, qui ont réuni durant deux jours près de 70 participants venus de toute l’Afrique. Experts en communication, représentants des Instituts Nationaux de Statistique (INS) et partenaires techniques ont partagé leurs expériences et leurs idées pour renforcer la diffusion et l’utilisation des données statistiques sur le continent.

« Vers une Afrique mieux informée : améliorer la communication des statistiques officielles pour renforcer la transparence et la gouvernance »Ces rencontres, organisées dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Union Européenne et l’Union Africaine, avaient pour objectif principal de renforcer les capacités des INS africains en matière de communication et de diffusion des données statistiques. Dans un monde où les données sont essentielles à la prise de décision éclairée, il est crucial que les statistiques officielles soient accessibles, compréhensibles et utilisées efficacement par tous.
Des recommandations concrètes pour des accessibles statistiques plus Les participants ont formulé des recommandations concrètes pour améliorer la communication statistique en Afrique, axées sur sept points clés :
• Renforcer la collaboration entre statisticiens et communicateurs au sein des INS.
• Améliorer les ressources et les capacités des unités de communication.
• Développer et mettre en œuvre des stratégies de communication partagées.
• Promouvoir la simplification et l’accessibilité des données.
• Investir dans des outils numériques modernes.
• Adopter une approche de communication centrée sur l’utilisateur.
• Promouvoir la sensibilisation et la culture statistique.« Les statistiques, un outil essentiel pour les décideurs et les citoyens. »
Ces recommandations visent à transformer la communication des statistiques officielles en Afrique, en rendant les données plus accessibles, compréhensibles et exploitables par les décideurs, les chercheurs et le grand public. Un appel à la collaboration pour une Afrique plus éclairée STATAFRIC et le PAS II appellent les INS et leurs partenaires a s’engager activement dans la mise en œuvre de ces recommandations.
« la communication statistique n’est pas qu’un uniquement un défi technique, mais une responsabilité partagée aux implications profondes pour la transparence, la gouvernance et le progrès social » a déclaré M. Adoum Gagoloum, Chef de la division des statistiques Economiques, STATAFRIC.
Prochaines étapes et perspectives d’avenir
« Les idées et stratégies développées ici doivent désormais être traduites en actions concrètes qui façonneront l’avenir de la communication statistique à travers l’Afrique » M. Adoum Gagoloum, Chef de la division des statistiques Economiques, STATAFRIC.
« Avec STATFRIC et nos partenaires, nous allons prendre en compte les résultats de cette rencontre et identifier les plans et actions possibles pour appuyer les Instituts Nationaux de nos Etats Membres pour l’amélioration de la communication des informations statistiques dans nos Etats Membres ». a souligné M. Adoum Gagoloum, Chef de la division des statistiques Economiques, STATAFRIC.
Le PAS II remercie chaleureusement l’Union Européenne, Eurostat, Expertise France et tous les participants, les partenaires et les organisateurs qui ont contribué au succès de ces rencontres stratégiques.
Megan Valère SOSSOU